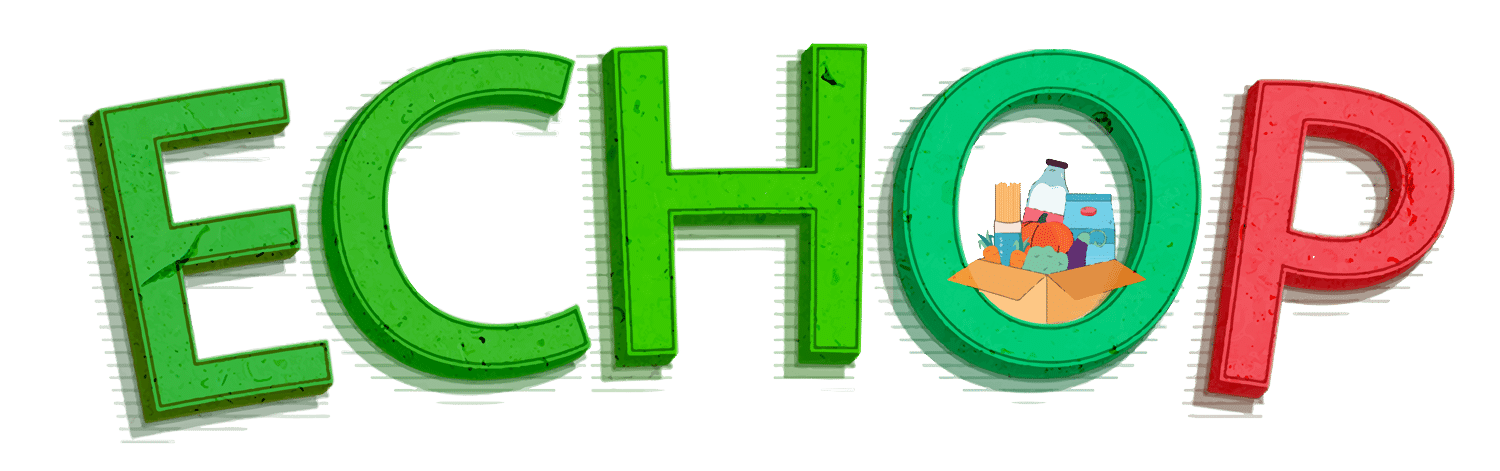- Acceuil
- All Courses
- Outil d’accompagnement ECHOP
Curriculum
- 7 Sections
- 34 Leçons
- 7 heures
Développer toutes les sectionsRéduire toutes les sections
- Introduction à l'outil d’accompagnement ECHOPLe projet ECHOP vise à accompagner et former les dirigeants des structures d’aide alimentaire afin de favoriser l’accès à une alimentation régulière de qualité et suffisante pour les publics en situation de pauvreté.3
- 1. L'Autoproduction au service de l’aide alimentaireL'autoproduction au service de l'aide alimentaire est une démarche globale qui vise à garantir un approvisionnement régulier et diversifié favoriser. Il a aussi pour objectif de favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité pour les bénéficiaires et de sensibiliser à l'agriculture durable et à l'alimentation responsable.6
- 2.11.1 Introduction et définition
- 2.21.2 Démarche pour mettre en place l’autoproduction au service de l’aide alimentaire
- 2.31.3 Bonne pratique d’Économie Solidarité Partage
- 2.41.4 Référentiel de compétences pour l’autoproduction
- 2.51.5 Tableau de bord de gestion des compétences pour l’autoproduction
- 2.61.6 Auto-évaluation sur l’autoproduction
- 2. GlanageAu sein de l'aide alimentaire, le glanage prend une dimension spécifique et solidaire. Il s'agit de l'action organisée de récupérer des denrées alimentaires encore consommables qui seraient autrement perdues ou gaspillées, dans le but de les redistribuer à des personnes en situation de précarité alimentaire. Il s’agit surtout de fruits et de légumes.6
- 3.12.1 Introduction et définition
- 3.22.2 Démarche pour mettre en place le glanage au service de l’aide alimentaire
- 3.32.3 Bonne pratique d’Espigoladors
- 3.42.4 Référentiel de compétences pour le glanage
- 3.52.5 Tableau de bord de gestion des compétences pour le glanage
- 3.62.6 Auto-évaluation sur le glanage
- 3. La transformation de denrées alimentairesC'est l'ensemble des opérations par lesquelles des produits bruts ou peu élaborés, récupérés auprès de donateurs ou issus de surplus, sont transformés – par cuisson, conditionnement, assemblage ou préparation – en denrées prêtes à la consommation et plus faciles à redistribuer.6
- 4.13.1 Introduction et définition
- 4.23.2 Démarche pour mettre en place la transformation de denrées alimentaires au service de l’aide alimentaire
- 4.33.3 Bonne pratique de Es-Imperfect
- 4.43.4 Référentiel de compétences pour la transformation de denrées alimentaires
- 4.53.5 Tableau de bord de gestion des compétences pour la transformation de denrées alimentaires
- 4.63.6 Auto-évaluation sur la transformation de denrées alimentaires
- 4. AchatsOn désigne ainsi l’ensemble des démarches par lesquelles une organisation de l’aide alimentaire acquiert des denrées alimentaires contre rémunération, afin de compléter ou diversifier l’offre disponible pour les bénéficiaires. L’achat peut se pratiquer auprès de producteurs, de distributeurs ou encore auprès d’associations « grossistes » intermédiaires.6
- 5.14.1 Introduction et définition
- 5.24.2 Démarche pour mettre en place l’achat sur fonds propres au service de l’aide alimentaire
- 5.34.3 Bonne pratique des Capucines
- 5.44.4 Référentiel de compétences pour l’achat
- 5.54.5 Tableau de bord de gestion des compétences pour l’achat
- 5.64.6 Auto-évaluation sur l’achat
- 5. DonsLe don est un acte social structuré autour de 3 notions : donner, recevoir et rendre. Le don n’est donc pas un acte neutre puisqu’il renforce des rapports sociaux et peut-être perçu comme une marque de reconnaissance.6
- ConclusionEn suivant ces modules d'accompagnement, vous avez enrichi vos connaissances et renforcé vos compétences au service de l’aide alimentaire. Vous faites désormais partie d’une communauté européenne engagée dans le partage et l’innovation. Continuons ensemble à coopérer pour un impact durable et solidaire pour les plus démunis.1